À Saint-Grégoire, sur les traces d'une Cadie oubliée
Cet été, de retour au Québec, j’avais l’intention de mieux connaître la région d’où vient ma famille maternelle. J’ai donc exploré le Centre-du-Québec et je fis une découverte historique insoupçonnée à Saint-Grégoire-le-Grand (Saint-Grégoire pour les intimes). Cette visite dans le Centre-du-Québec m’a rappelé qu’autour du noyau d’appartenance que constitue la langue s’agglutinent des cultures différentes qui diversifient le tissu social. C’est le cas des petites Cadies fondées au lendemain du Grand Dérangement qui formèrent un archipel acadien dans le cœur du Québec francophone et qui, loin de se fondre dans la majorité, préservèrent leur identité.
C’est par hasard en fouillant sur Internet que j’appris que Saint-Grégoire, aujourd’hui une banlieue paisible de la ville de Bécancour, hébergeait le musée acadien administré par la Société acadienne Port-Royal (SAPR). En entrant dans la ville de Saint-Grégoire, il est fascinant de se voir accueillir par des drapeaux acadiens et de constater que le nom des rues porte fièrement le patronyme acadien, ainsi que les hauts lieux de l’histoire de l’Acadie (Grand Pré, Port-Royal, Beaubassin, etc.).

Le musée constitue un petit complexe comprenant l’église Saint-Grégoire-le-Grand, un moulin qui a fêté son bicentenaire et un couvent construit en 1912. C’est dans ce couvent que le visiteur est convié à découvrir l’histoire des Acadiens du Centre-du-Québec. La première salle est dédiée aux Sœurs de l’Assomption venue directement de l’Acadie pour enseigner aux enfants de Saint-Grégoire dès 1853. Toutefois, l’attrait principal du musée est la grande salle sur l’histoire de la petite Cadie de Saint-Grégoire.

On y apprend que pour avoir refusé de prêter serment au conquérant britannique, les Acadiens ont été déportés en 1755 au cours d’une vaste opération militaire de purification ethnique. Toutefois, entre 3000 et 4000 d’entre eux (sur une population de 13 000 âmes) réussirent à s’enfuir dans les bois et à rejoindre la vallée du Saint-Laurent qui était à ce moment-là encore un territoire français. Après la Conquête de la Nouvelle-France, les Acadiens furent autorisés à rester, mais ils craignaient toujours les représailles des Britanniques. Ils choisirent donc de s’installer dans des endroits reculés comme Saint-Grégoire où ils pourraient refaire leur vie. On retrouve ainsi beaucoup d’Acadiens qui se réfugièrent au nord de Montréal dans la région de Lanaudière. Isolés de la population canadienne-française déjà installée dans la vallée du Saint-Laurent, les Acadiens préservèrent leur culture et leurs traditions. À chaque 15 août, ces petites Cadies (au nombre de treize) vibrent au rythme de la fierté acadienne en fêtant leur fête nationale, le Tintamarre.

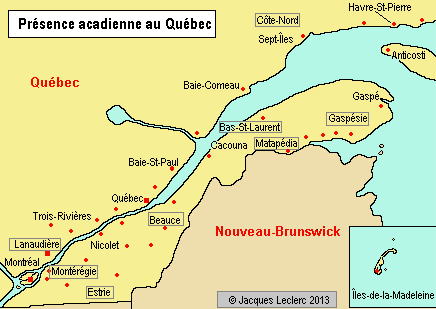
Source : Nouvelle Acadie

Source : Les tambours du patrimoine
L’autre grand attrait acadien est l’église Saint-Grégoire-le-Grand construite de 1803 à 1806, puis agrandie entre 1850 et 1855, grâce aux sacrifices de ses paroissiens qui, on s’en doute, étaient très démunis après avoir survécu au Grand Dérangement. L’aspect extérieur impressionne par sa majesté, mais à ma grande surprise l’intérieur possède un caractère sobre et dépouillé qui tranche avec les autres églises catholiques du Québec, dont le décor est somptueux et surchargé de richesse et d’ornements. Est-ce que cette église témoigne des tourments subis par les familles acadiennes qui avaient trouvé refuge dans le pays de Saint-Grégoire et qui souhaitaient un lieu de culte qui respire la paix et la sérénité? Peu importe leurs intentions, le visiteur ne peut être que touché par la beauté des lieux et la simplicité qui y règne.

Source : Bécancour (Saint-Grégoire)

Aujourd’hui, plus de 1,2 million de Québécois descendent des Acadiens. Une population qui surpasse les Acadiens des Maritimes. De plus, la contribution génétique des Acadiens à la population régionale atteint 86 % aux Îles-de-la-Madeleine, 27 % en Gaspésie, 14 % sur la Côte-Nord et entre 6 et 8 % dans le Centre-du-Québec, Lanaudière, la Mauricie et le Bas-Saint-Laurent.

Cette histoire me fait penser au Manitoba français qui a été lui aussi le résultat de plusieurs apports culturels francophones comme les Canadiens français, les Autochtones, les Métis, les Franco-Américains revenus d’exil aux États-Unis, les Français et les Belges. Un processus de brassage culturel qui se poursuit toujours avec l’arrivée de francophones en provenance du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne, des Antilles, du Proche-Orient et du Vietnam. Preuve que la langue est parfois le buisson qui cache une forêt luxuriante. C’est la diversité des apports migratoires qui façonne et refaçonne au fil des générations l’identité culturelle d’une collectivité. Heureusement, le musée de la Société acadienne Port-Royal à Saint-Grégoire est là pour nous le rappeler, alors que le temps efface parfois le chemin parcouru par nos ancêtres au sein de la mémoire et de la culture collectives.




